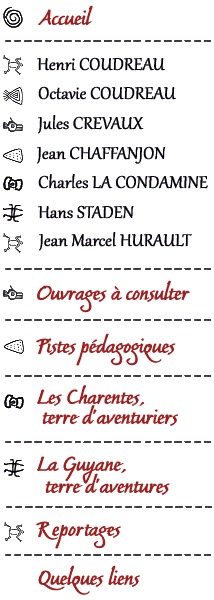
 Henri Coudreau
Henri Coudreau« On est pris de la rage d’explorer. Il n’y a lycéen qui ne rêve une fois d’être le Christophe Colomb de quelque rivière ou de quelque que tribu. »
Henri Anatole Coudreau est né en Charente-Inférieure (Charente-Maritime), dans le petit village de Sonnac le 6 mai 1959. Enfant, il aspirait, dit-on, à devenir marin, mais sa famille voulait en faire un notaire. En 1877, il entre à l’Ecole normale spéciale de Cluny, mais avoue qu’il ne songe pas à l’enseignement : « le but entrevu, ce sont les missions scientifiques ». Etrange vocation, car il est d’origine modeste, son acte de naissance indique que son père Henri Coudreau et sa mère Marie Coudreau, née Joubert, sont cultivateurs.
Il obtient en 1880 une chaire d’Histoire-Géographie à l’Ecole professionnelle de Reims. Muté au lycée de Clermont-Ferrand, après avoir postulé en vain pour une place dans la mission transsaharienne de Flatters (malheureuse mission, qui périt, massacrée quelques mois plus tard), il demande alors « un poste quelconque dans une colonie quelconque » et obtient en 1881, à 21 ans un poste d’enseignant d’histoire et de géographie au lycée de Cayenne (Guyane française). Cet établissement s’appelle aujourd’hui « collège Eugène Nonnon », toujours situé au 22 avenue Léopold Héder à Cayenne.
Républicain convaincu, d’origine protestante mais âpre défenseur de la laïcité, il ne sait presque rien de la Guyane, qu’on appelle encore la France équinoxiale, ni de l’Amazonie. Mais Henri Coudreau se passionne pour cette région, tout en assurant son travail d’enseignant d’histoire et géographie, il rêve d’exploration, et s’intéresse particulièrement à la cartographie.
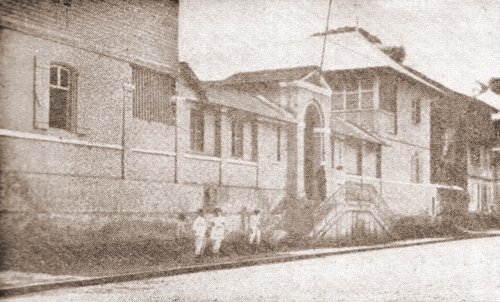 Une vocation d’explorateur
Une vocation d’explorateurIl n’y a pas de formations, d’écoles, d’instituts pour devenir explorateur. Tous les explorateurs sont mus par une curiosité, une passion, l’appel de l’aventure. Henri Coudreau ne pourra résister très longtemps à l’envie de pénétrer les secrets de la « Grande forêt de la pluie », selon l’appellation que les Amérindiens avaient donné à la forêt amazonienne. Il partira, au début à l’aventure, profitant des vacances scolaires, puis il montera des missions plus officielles, avec le projet de dresser la cartographie de la Guyane. Equipé d’un matériel rudimentaire (cartes hollandaises et cartes de Crevaux, boussole, podomètre, baromètre), il doit dresser le cours des rivières, observer la nature des sols, et surtout veiller à noter l’orientation et la distance de ses itinéraires. Les distances sont estimées en fonction de la durée de leur parcours à pied ou en pirogue. Il utilise pour cela une montre et une boussole : « J’ai compté au podomètre 59 490 pas, et à ma montre 10 heures 5 minutes de marche. J’évalue la longueur de la route à 43 kilomètres, y compris les sinuosités ».
Il complète ses notes par des croquis et des photos. La photographie, qui en est à ses débuts en cette fin du XIXe siècle, permettra de rapporter les images des pays lointains. Des revues sont créées en Europe (Le Tour du Monde) qui populariseront les récits des explorateurs, accompagnés de photos des paysages et des peuples qui émerveilleront les lecteurs. Il ne faut pas oublier que la France, l’Angleterre, la Belgique, les Pays Bas… développent alors une politique coloniale, organisent des Expositions internationales, et que l’image témoigne de cette « vision blanche » des régions d’Outre-mer.
 Monter des expéditions
Monter des expéditionsCoudreau doit tout apprendre du métier d’explorateur : observer comme un botaniste, découvrir des peuples inconnus comme un ethnologue et comme un géographe dresser les cartes des contrées jusqu’alors inconnues. Il lui faut apprendre également à aller frapper à toutes les portes afin d’obtenir les crédits nécessaires à ses missions. Avec l’aide de Charles Maunoir, attaché au ministère, puis Secrétaire à la société de Géographie de Paris, il finira par décrocher des crédits du sous-secrétariat d’Etat aux Colonies, puis au ministère de l’Instruction publique entre 1885 et 1893.
Sa première mission commence en 1883 : à la demande du sous-secrétariat d’Etat aux Colonies, il est chargé d’explorer les territoires contestés entre la France et le Brésil. Il se passionnera toujours pour cette question, argumentant, proposant des solutions d’implantation de fermes et de colons dans cette région située entre l’Oyapock et l’Araguari. Il outrepassera même les objectifs de la mission qui lui avait été conviée et recevra les avertissements et les mises en demeure du gouvernement français. C’est l’affaire du fameux « Contesté franco-brésilien ».
Il sera chargé par la suite de missions moins sensibles (il n’en oubliera pas pour autant ses prises de positions sur le Contesté) avec l’exploration des fleuves Tapagos (1895), Xingù (1896), Tocantins (1896).
Ce sont des missions difficiles, Coudreau et son équipe doivent affronter mille dangers : les rapides des fleuves, appelés « sauts en Guyane », car il faut alors décharger les pirogues et passer le matériel et les bagages par la rive, les basses eaux qui sont des pièges avec les troncs d’arbres immergés, les blessures infligées par les sangsues, les serpents, supporter les fièvres et parfois faire face aux attaques des Indiens munis de flèches empoisonnées au curare. Un jour, la pirogue chavire et Coudreau voit partir tout son matériel à la dérive, un autre jour il tombe à l’eau, lui qui sait à peine nager… Coudreau est souvent accompagné d’Apatou qui fut le fidèle guide de Jules Crevaux. Une sorte de rivalité semble, d’ailleurs, opposer les deux explorateurs, Coudreau rêvant de faire mieux que son prédécesseur. Il reprend ses itinéraires pour vérifier ses observations, il corrige ses cartes et ses croquis. Les cartes de Coudreau présenteront néanmoins quelques erreurs et oublis qui seront, à leur tour, corrigées par Jean Hurault au début du XXe siècle.
Coudreau, comme Crevaux est attiré par les montagnes mythiques des Tumuc-Humac. A cette époque encore, la légende de l’Homme doré (l’Eldorado), la ville aux toits couverts d’or de Manoa, le lac Parimé, attirent toujours aventuriers et explorateurs. Mais il est très difficile, aujourd’hui encore, de parcourir à pied la distance qui sépare les villes de Maripasoula sur le Maroni et Camopi sur l’Oyapock. Par ailleurs la zone située au sud de la ligne qui joindrait ces deux villes est toujours appelée « zone réservée », d’accès interdit sans autorisation, c’est le territoire des derniers Amérindiens, l’accès à la ville de Camopi est également administrativement réglementé. De toute façon du temps de Crevaux et de Coudreau, pas plus qu’aujourd’hui, n’existe de chemin tracé à travers la forêt et le « sentier des Emerillons » ne représente qu’une infime partie du trajet quand il n’a pas disparu dans la végétation. Coudreau effectuera un parcours de reconnaissance dans la partie nord-ouest dans le Haut Marouini, puis à l’occasion d’un autre voyage dans le sud-ouest dans le Haut Oyapock et le Kouk. Il donnera son nom à un pic, le pic Coudreau, comme Crevaux avait nommé le pic Lorquin, du nom de sa ville natale.
Comme le relèvera Jean-Marcel Hurault, cette exploration est marquée d’imprécisions et d’erreurs : « Coudreau eut l’impression qu’en se dirigeant vers le nord-ouest, il rejoindrait le Haut Marouini, complétant ainsi par une randonnée sensationnelle sa représentation des Tumuc-Humac. Partant de Ouira, village situé aux sources du Maïpoké, affluent du Kouk, il se dirigea vers le nord. Après quelques jours de marche, il arriva aux sources du Kérindioutou et probablement aux sources du Camopi, qu’il prit pour celles de l’Ouanapi. Il aperçut au nord une montagne plus élevée, et compulsant ses notes d’un précédent voyage il identifia cette montagne « affectant la forme d’une molaire », comme le pic d’Amana qu’il avait escaladée l’année précédente. Il se trompait lourdement. Le pic d’Amana était à plus de 100 km vers l’ouest, distance absolument impossible à parcourir dans la forêt guyanaise, où l’on ne peut guère progresser de plus de 4 à 5 km par jour en moyenne en ouvrant un tracé » (Montagnes mythiques : Les Tumuc-Humac, in Les Cahiers de d’Outre-mer ed. 2000).
Au cours de l’année 1889, il effectue une mission sur le fleuve Yamounda. Déçu par les autorités françaises (certains lui ont même prêté un rôle d’agent double…), Coudreau est alors passé au service des Brésiliens. A leur demande il explore le cours des affluents de l’Amazone avec pour objectif d’y repérer les zones propices à l’établissement d’exploitations forestières (bois et plantations d’hévéas) ou de plaines herbeuses (les campos) pour l’élevage.
En cette fin d’année 1889, il effectue des repérages sur la rivière Trombetas, au nord de la ville d’Obidos dans l’Etat de l’Amapa (Brésil). Il est accompagné de sa femme Octavie. Malade, épuisé, il meurt dans ses bras, terrassé par une fièvre paludéenne le 10 novembre, à l’âge de 40 ans.
Avec un courage exemplaire, Octavie trouvera les forces pour lui dresser une sépulture près du lac Tapagem, les planches du canot servant de cercueil. C’est d’ailleurs Octavie, à partir du chapitre VIII, qui poursuivra le récit de cette exploration. Par la suite elle entreprendra, elle-même, plusieurs explorations au service de l’Etat brésilien. Elle parviendra, en 1904 à ramener les restes d’Henri Coudreau. Il repose désormais dans le caveau familial à Angoulème.
Au cours de ses voyages d’exploration dans la forêt, Henri Coudreau note et dessine minutieusement sur ses carnets les coiffures, les danses, les musiques, les vêtements des peuples amérindiens qu’il rencontre. Il rédige un ouvrage entier sur les mots utilisés par les Indiens Vocabulaires méthodiques des langues Ouayana, Aparaï, Oyampi, Emerillon (Paris, 1892)
Mais, il s’extraie difficilement de l’ambiguïté des clichés de l’époque concernant les « sauvages » dans une vision peu romantique de la vie des Indiens. Henri Coudreau est souvent excédé par l’attitude dont sont capables les indigènes sans cesse curieux de sa barbe, de ses vêtements, de ses gestes et de son matériel d’exploration. Mais ce qui l’irrite le plus chez ses guides, c’est l’absence de volonté et de détermination : les Indiens qui veulent l’empêcher de faire un long séjour refusent d’avancer après une marche d’une heure et demie ! Pire, ils se relèvent la nuit pour manger les provisions, afin que le retour soit plus rapide. Il supporte encore plus mal cette spontanéité quand il s’agit de se servir dans ses malles de voyages, de mentir sans raison ou quand on l’assène de questions sur le pays des Blancs. Pour Coudreau les Indiens sont « déroutants ».
Au cours de ses premiers voyages, Coudreau réagit avec tous les préjugés, les clichés, les à-priori qui étaient ceux des colons de l’époque, parfois même, teintés d’un peu de racisme, lequel était malheureusement commun dans la société de la Troisième République. Au fur et à mesure on voit son jugement se modifier, jusqu’à prendre en grippe les fonctionnaires blancs et créoles des villes de la côte (ce qui lui sera longtemps reproché). Déçu par la politique coloniale de Jules Ferry, lâché par le gouvernement sur la question du Contesté, c’est un homme désabusé, en proie au doute sur les finalités des missions qui lui sont confiées. Il a beaucoup vécu dans la forêt, beaucoup côtoyé les Indiens pour lesquels il montre maintenant un véritable attachement. Face à la menace qui pèse sur la survie des tribus, il défend le projet, sans doute utopiste, d’un mode de vie indien compatible avec les sociétés occidentales. Fervent adepte des théories rousseauistes, il a grandi dans le mythe du « bon sauvage », vestige d’un âge d’or détruit par la civilisation moderne. L’ancien professeur, pétrit d’humanisme ne peut qu’être horrifié par la corruption et la décadence que l’Europe colporte en dehors de ses frontières, chez des individus incapables de se protéger. Il se fait le devoir de décrire les villages décimés par la variole, qu’il traverse. Tout en faisant l’apologie de sa nation et du progrès colonisateur qu’elle véhicule, Coudreau déplore une telle évolution. Il n’en est pas à son premier paradoxe près, mais tente de le résoudre dans l’élaboration utopique d’une nouvelle race, fruit du croisement de la race blanche avec la race indienne. De fait, comment concilier mœurs primitives et civilisées, insouciance et raison, équité et progrès, si ce n’est en préconisant la solution du métissage. Il développe longuement cette vision dans la conclusion de l’ouvrage Chez nos Indiens. Quatre années dans la Guyane française (Paris 1893).
En dépit de certains clichés, Henri Coudreau n’est pas un simple aventurier, recherchant seulement l’action et la découverte de contrées inconnues. Scientifique désabusé et déçu par ses compatriotes ou agent secret « passé à l’ennemi », il laisse une empreinte dans l’histoire de la Guyane et du Brésil comme l’un des principaux explorateurs des Etats de l’Amapà et du Parà.
En savoir plus : Henri Anatole Coudreau, dernier explorateur de la Guyane. BENOIT Sébastien, L’Harmattan, Paris, 2000.
A lire également : Le contesté franco-brésilien | La république du Counani